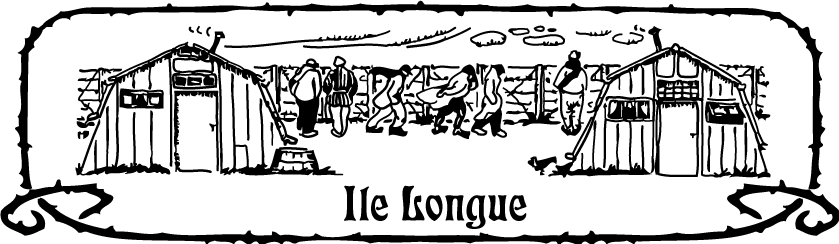Dans son livre « Erlebnisse aus Freiheit und Gefangenschaft » (Expériences vécues en liberté et en captivité) paru aux éditons S. Fischer, Berlin 1919, l’écrivain allemand Hermann von Bötticher, relate les différentes étapes de sa captivité, à commencer par l’interception surprise du « Nieuw-Amsterdam » par le croiseur auxiliaire français « La Savoie », suivie par la mise en captivité de ses passagers, leur installation provisoire au Fort de Crozon, puis sur le « Charles-Martel » au port de Brest, l’aménagement du camp sur l’Ile Longue et la vie du camp jusqu’en 1917, année de son transfert en Suisse.
Hermann von Bötticher, 1887 – 1941, prisonnier au camp de l’Ile Longue de 1914 à 1917, est un poète, écrivain et dramaturge allemand qui, faisant partie du mouvement artistique dit ”expressionnisme”, ne se soucie guère des convenances linguistiques et notamment lexicales. C’est ainsi que, dans son texte, un navire “nage”, les brouillards “roulent” et les rayons du soleil sont “martelants”. Si déjà dans la langue d’origine, l’allemand, le choix de certains mots est pour le moins étrange et certains passages sont à peine compréhensibles, le lecteur français risque d’être sérieusement gêné et pourrait même mettre en cause la qualité de la traduction. Qu’il fasse preuve d’indulgence à l’égard d’un écrivain-poète qui voit et décrit le monde à sa façon très personnelle et qui, quelques années plus tard, va sombrer dans la folie. En ce qui concerne le traducteur, il se doit de respecter les particularités du texte d’origine et, justement, éviter d’en lisser les aspérités.
Pour plus d’informations sur l’auteur voir l’article Hermann von Bötticher, interné civil au camp de l’Ile Longue, et sa tragédie “Jephta”.
I
Nous nageons sur la mer. Le nom du navire : « Nieuw-Amsterdam ». Sa destination : Rotterdam.
Le port de New-York est derrière nous, la barre des maisons hautes déchirant le ciel ne danse plus et le dernier salut d’adieu des Etats-Unis, la statue de la Liberté, est plongé dans l’obscurité de la nuit.
Il fait tout doux sur le pont, pas un souffle. Les pionniers du commerce allemand y sont allongés et prennent leur bain de soleil. Ils viennent du Chili, du Brésil, de la Bolivie, du Pérou, de la Colombie, du Venezuela, du Costa Rica, du Panama, du Guatemala, de l’Equateur ou du Mexique, d’autres des Etats-Unis et du Canada. Ils ont laissé des dépôts de marchandises, des usines et bureaux avec leur travail florissant ou aussi des fermes isolées et plantations, des pampas étendues, des mines sombres et des steppes ventées –
Dans leur tête une seule et puissante exigence :
Retour ! La patrie est en péril.
Et ainsi ils regardent à travers le bordé sur la mer et voyagent remplis de joie vers un destin inconnu.
Le septième jour, ils aperçoivent à l’horizon le premier navire. Tout le monde se précipite sur le pont, pose les jumelles et vérifie : il s’agit d’un vapeur faisant cap à l’ouest. Du calme ! Pourquoi s’exciter ?
Les uns disent : nous n’échapperons pas à ce qui nous est destiné. Les autres disent : Nous sommes sur un bateau neutre. Une chose est sûre : La ligne hollandaise a annoncé : « Nous accueillons à nouveau des Allemands à bord. »
Arrive le dernier soir.
Tout le monde est content et joyeux, boit et chante.
Nous voilà déjà dans la Manche.
Il fait une nuit magnifique : noire, profonde ; dans une cape de velours, les étoiles ; un doux vent chaud touche les cheveux comme une main.
La poitrine est remplie de vie.
« Mon capitaine, comment ça va ? »
« Excellemment bien, Monsieur, excellemment bien. »
« Toujours pas de navires de guerre en vue ? »
« Suffisamment. Mais ils ne nous font rien. »
« Français ou Anglais ? »
« Anglais ! »
« Quand serons-nous à quai ? »
« Demain matin à dix heures. »
« Quand je me réveillerai, je verrai - ? »
« Les tours de Rotterdam. »
« Bonne nuit, Capitaine ! »
« Bonne nuit. »
Il est minuit. Avant de me coucher, près du bordé, je déchire une photo. Les petits morceaux s’envolent dans la nuit :
« Nous allons nous revoir à Paris », dit-elle.
« Quand ? », je lui demande.
« L’hiver 15 », dit-elle.
Qui rit ? La mer ? Le vent ?
Je dors d’un sommeil profond. Est-ce que je rêve ? Un bruit de tonnerre. Maintenant, encore une fois, et encore deux coups. Sortir du lit, monter sur le pont !
En vêtements de nuits, cachés sous des couvertures, gris dans du blanc, voilà déjà un groupe compact de personnes vacillant dans l’un et dans l’autre sens, les regards fixés dans le matin.
Il est quatre heures, et pas un souffle de vent. Sur la mer, d’un blanc lourd jusqu’au violet, la brume, le soleil, noir et rouge, sans lueur, au milieu. Tout près de lui, à peine perceptible, une ombre qui avance lentement ; d’un navire la coque incertaine.
Puis, les officiers et les stewards de notre bateau courent de tous côtés et donnent l’ordre de nous mettre en rangs.
« Que se passe-t-il ? »
« Un croiseur auxiliaire français. »
« Rien de plus ? »
« Je pense, cela suffit. »
Attendons !
Notre navire est arrêté.
Les brouillards roulent silencieusement au-dessus de la mer, le soleil les perce avec ses rayons martelants. Devant nous le navire étranger. Comme s’il dormait, peint de noir et apparemment vide. Depuis son mât pend un drapeau bleu (ou noir), blanc, rouge. On ne peut le reconnaître distinctement. Sur sa coque sied (est assis), malheureux et sourd, le nom « La Savoie ».
Sur les ponts de notre bateau éclairé, les passagers de nationalité allemande et austro-hongroise se tiennent en longues rangées pour se faire compter.
Des messages radio et des signaux par fanions ainsi que des appels passent au-dessus de leurs têtes, puis nous entendons l’ordre :
« Mettre en panne et retour dans la Manche ! »
Les rangées se dissolvent et se transforment en amas épais. Des gesticulations et des protestations se font jour ; le petit capitaine hollandais aux joues rouges fait son apparition. Il est malheureux et transpire doucement et réplique aux Français.
Puis, une chaloupe descend du pont d’à côté, se pose sur l’eau en clapotant et, dans la lumière bienveillante du soleil, avec des personnes bleues aux visages rouges à bord, s’approche de notre bateau.
Après un instant, des officiers et douze matelots surgissent sur le pont. Ils ont l’air paisible, mais se mettent en rang sur le pont avant.
L’officier, un homme jeune au teint délicat se pose devant eux et donne des ordres – sa voix est d’une sonorité sombre et timide, ses joues sont échauffées, son œil caché par de longs cils :
« Chargez vos fusils ! »
Les hommes chargent ; avec leurs doigts maladroits de pêcheurs ils manient des cartouches fines, sveltes, jaunes et pointues. Cela dure longtemps et est difficile. Sous les nombreux regards, il y en a un qui laisse tomber l’arme sournoise. Des rires. Les gars aux joues soufflées deviennent rouges d’embarras). L’un ou l’autre s’efforce de montrer un regard têtu et menaçant. La société des messieurs et dames répond par un sourire. Un Breton à la tête ronde et blonde n’arrive pas du tout à préparer son instrument de tir. A travers ses mouvements on sent qu’il est gêné par l’idée que ce fusil est chargé pour ces personnes-là qui sourient.
Alors, le lieutenant français au visage de jeune garçon s’approche du malheureux pour le secourir, - mais lui non plus ne vient à bout de cette vétuste arme meurtrière, destinée aux hommes ; son visage comme inondé de sang, il doit l’abandonner et se remet à donner des ordres.
« Mettez vos baïonnettes sur les fusils ! »
Cela réussit.
Le soleil, scintillant, joue avec l’acier et puis, en passant sur les couteaux, carressant, avec l’embarras dans le visage du jeune homme.
Il doit encore faire charger les revolvers et faire répartir les postes sur le pont ; après cela son devoir est accompli et le paquebot neutre occupé.
“La Savoie” salue avec son pavillon et fait signe. Les hélices de notre bateau démarrent et, accompagnés par notre gardien derrière nous, nous refaisons tout le chemin parcouru pendant la nuit.
Vers le soir, des côtes légèrement voilées luisent du côté sud, mais, à la nuit tombante, elles s’éloignent.
Alors, tout à coup, nous sommes dans la rade de Brest.
Le gardien, grand et sombre, a disparu. Un, deux, trois, quatre petits torpilleurs se sont rapprochés bruissamment. A l’aide de porte-voix, ils échangent des ordres entre eux et nous plongent dans de grands faisceaux lumineux. Je ressens en moi une impression de fête.
Qu’est-ce qui se passe ?
Des appels vers nous, sur le haut du bateau. De notre pont, l’équipage réplique.
Tout doucement, nous glissons ; un bruissement sourd, nous nous arrêtons.
Autour de nous, le port scintillant.
II
La nuit est passée, le matin brille d’un éclat rose et frais. Le port est bleu et scintille, l’air est clair. Des mouettes volent autour du bateau, dans une lumière blanche rayonne du haut de ses collines : Brest.
En longues lignes, leurs bagages portables sur les bras, les peuples allemands et austro-hongrois quittent le bateau.
Des barques à charbon son amarrées à l’avant et à l’aarière et attendent patiemment.
Un escalier amovible et une planche mênent les passagers en sécurité depuis le “Nieuw Amsterdam” dans leurs ventres sales :
des Messieurs à barbe blanche en redingote claire ;
de jeunes gens sauvages, le menton non rasé ;
des hommes du monde affichant de l’indifférence ;
des gars carrés au regard d’acier ;
des vieillards simples, au front baissé et triste
et de la jeunesse souriante, à l’oeil vif.
Ils quittent le bateau en un défilé interminable ; sur leur côté de modestes Bretons, les revolvers chargés, font la haie. Depuis toutes les ouvertures du bateau, des gens émus font signe en agitant les bras ; en haut, sur les ponts, les stewards de la Holland-Linie, sont alignés comme des pingouins dans leur blouses blanches et ne bougent pas.
De petits remorqueurs, comme des cygnes ballonnés, arrivent en s’ébrouant et retirent en s’efforçant les barques remplies.
Vers où ?
Eh bien, quelque part.
Encore des appels qui se croisent.
“Salue l’Allemagne !”
“Pense à Wilhelmine !”
“Envoie-moi les couvertures, tu entends !”
“Que mère ne se fasse pas des idées !”
“Demain nous serons à nouveau libres !”
“Pas avant la fin de la guerre !”
“Alors à la Noël !”
“Au plus tard !”
“Adieu !”
“Adieu !” (en français dans le texte)
Les jeunes femmes à bord pâlissent, leurs maris dans les barques à charbon deviennent rouges. Encore des voiles qui font signe, une forêt blanche de mains et de voiles. Puis, on ne voit plus que le navire.
“Vous êtes bien des chiens !” grince quelqu’un qui n’est pas encore lucide.
Autour de nous le flot le plus bleu qui clapote. Ma main gauche est plongée dans les vagues. Ma droite touche un pied rudement chaussé. Mon regard monte vers son visage rouge-marron. J’y vois des yeux bleus foncés qui, d’un air naïvement pensif, regardent les miens de couleur verte. Je regarde à nouveau vers le bas, sur son pied grossier. Il appartient à mon ennemi dans le bateau.
Brest, la ville blanche, ne luit plus que faiblement jusqu’à chez nous. Des îles vertes, voilées par l’air bleu, nous font signe depuis la rade profondément ramifiée, des dauphins se lancent vers nous à travers les vagues et, à partir de côtes couvertes du jaune de genêst, des rochers se jettent dans la mer.
Le soir arrive ; une obscurité mate et douce. Nous touchons la terre et, à travers de galets humides qui ont l’odeur des algues, nous escaladons à la plage.
Le petit port de pêche gris-blanc est rempli de voiliers au repos. Partout des filets pendus, des pêcheurs fatigués dans l’attente du soir. Leur vie, pleine de nostalgie mystérieuse, nous salue. Depuis de coteaux verts et d’or se détachent des personnes rouges et bleues. Des appels sombres comme le soir résonnent à travers l’air. Soudainement, toutes les choses sont liées les unes aux autres dans une relation profonde et mystérieuse. Des visages, abattus et tendant l’oreille, regardent du fond de la semi-obscurité ; des femmes bretonnes, des garçons et des filles, en sabots clapotants, s’approchent et croient voir des fantômes.
Des baïonnettes et le rouge des uniformes brillent... En une longue colonne, nous passons près de dures crosses de fusils.
Les maisons se retirent de plus en plus profondément dans la nuit, à travers leurs fenêtres se brise de la lumière jaune. La rue passe entre le port et le village. Devant un bâtiment bas, une crèche à chèvres abandonnée, nous nous arrêtons. La porte est grande ouverte, des postes des deux côtés armés de fusils étincelants. A travers cette porte, nous passons nos bagages vers l’obscurité et poursuivons notre marche dans une colonne interminable.
Derrière nous une voix qui refuse ; elle se perd au loin. Nous continuons la marche. Des officiers sur des chevaux effarouchés. Puis, dans le silence tendu, le bruit d’un coup. Des cris de femmes remplissent l’air ; suit un deuxième et un troisième coup : à l’intérieur de nous quelque chose s’arrête. Vers l’extérieur le corps se tend, le poing se cramponne.
« Qu’est-ce qu’il y a, Caporal ? »
« On vient de tuer, silence ! »
Le paysage se tait. L’obscurité respire. Les officiers passent en galopant le long des colonnes. Des ordres sont passés : quiconque quitte le rang sera fusillé. Amis et ennemis, tous se taisent. Une méchante odeur traverse l’air ; il frémit ; la nature est partagée en deux.
Il fait complètement nuit. Nous marchons. La lune a rempli l’obscurité de lumière blanche et d’ombres plus profondes. Des profondeurs de la nuit émergent des groupes d’arbres serrés et vivants. Des vallées boisées et des collines frémissent, le paysage regarde rêveur vers la rade ; nous nous en éloignons et y revenons. Tout est infini. La route s’écoule à travers la nuit comme une rivière doucement rayonnante. Quand elle monte je vois des fusils et des baïonnettes briller dans le clair de lune. Telle une vision, la colonne de sombres formes humaines s’étire sur la vague d’une colline et se démarque contre le ciel et la nuit.
Au bout d’une heure, nous traversons un village. Une nouvelle heure plus tard, un autre. Un pasteur octogénaire s’écroule et est déposé sur un brancard ; son fils se tient à ses côtés et aide à le porter jusqu’à ce qu’une sentinelle le refoule.
Puis, en haut, nous atteignons un champ. Il est chauve. Des buissons de genêts et de minces bosquets de pins, traversés par le scintillement argenté de la mer. L’océan Atlantique.
Nous sommes répartis en groupes. Dix-sept groupes de 70 hommes chacun. Il fait froid ici en haut, le vent de la Manche souffle. De nouvelles équipes de garde surgissent devant nous. Les Français sont excités. Ils ne savent pas qui nous sommes.
Puis les premiers groupes se mettent en marche. Après un petit moment, nous suivons. Mais à peine partis, on nous ordonne de nous arrêter à nouveau. Nous nous trouvons devant un mur avec une porte.
C’est un puits sombre et puissant qui mène aux enfers.
Quand nous y pénétrons, nous reconnaissons un fort. Nos pas résonnent. Nous traversons un espace intermédiaire de remparts. Des canons se dressent silencieusement au clair de lune, regardent sur la mer et brillent. Puis vient une deuxième porte. Nos pas résonnent à nouveau, mais soudainement nous sommes dans une cour enfermée. Autour de nous un va et vient excité de lanternes, de soldats, de fusils et d’officiers. Dans le mur longitudinal de notre côté il y a des ouvertures barrées de grilles de fer, à la place de fenêtres et de portes. On nous appelle à voix basse. Nous nous efforçons de voir et apercevons derrière des taches de visages et des mains qui se posent sur les grilles comme des pattes de chiens.
Ce sont les premiers groupes de notre colonne.
Puis c’est notre tour. A travers de sombres couloirs, nous montons un escalier, à nouveau dans un couloir insondable : puis Halte ! Les sentinelles déposent les fusils, en un bruit retentissant. Les lanternes éclairent les visages par en-dessous : l’humanité se crée un monde fantomatique. La clé du caporal est rouillée et grince dans la serrure. Quand la porte s’ouvre, nous vacillons dans une blême salle voûtée. Au milieu, un tas de paille pour notre couchage.
La porte se ferme en claquant.
Dans l’obscurité, soixante-dix hommes, en tâtant, se préparent une place de couchage. L’air est irrespirable. Ici aussi, des barres de fer à la place de fenêtres.
« Berné ! », s’exclame un Hambourgeois et me crache dans la main.
Une demi-heure plus tard, un bruit de ferraille, dehors dans le couloir. La porte s’ouvre, entrent une lanterne et deux sentinelles baïonnette au canon, et, entre les deux, un officier de grande taille, un revolver dans sa main tendue en avant :
« Restez coucher, sinon je tire », s’exclame-t-il doucement. Puis, des soldats, derrière lui, apportent à manger et un tonneau pour les besoins. L’officier de grande taille, quant à lui, nous déclare prisonniers et, retirant le revolver, nous laisse seuls.
La nuit est passée, chuchotements, gémissements, ronflements, jurons et rêves. Une clarté grise se fraye un chemin en petits traits à travers les fenêtres barrées. De frissonnantes formes humaines froissées comme du linge sale se redressent et se regardent les unes les autres dans leurs figures transformées.
De la paille dans les chemises et les cheveux, les yeux sont petits et rouges, les visages tâchés ou blêmes.
Il est 5 heures.
Un signal de cor résonne contre les murs.
La vie reprend au fort. Des sabots de bois claquent dans la cour, je pose mon front contre les barreaux des fenêtres et vois des soldats, à travers les fentes, dans la brume matinale. Lentement je distingue par fragments l’intérieur du fort.
Devant moi un mur avec des fenêtres ouvertes sur des soldats barbus qui s’habillent.
Partout du rouge argile et du bleu. Des fusils ça et là, on nettoie des baïonnettes, on mange du pain, on se peigne les cheveux et on boit du café noir.
Sur le mur latéral de la cour oblongue une porte ouverte d’où s’échappe de la vapeur et où s’engouffrent sans cesse les défenseurs de la patrie avec des pots vides et en ressortent les pots remplis de noir.
Beaucoup d’eux sirotent la boisson fumante dès l’encadrement de la porte.
Puis, des ordres et d’autres signaux de cor.
Le lieutenant grand et craintif de la nuit apparaît, les vieilles gens se mettent pitoyablement en rang, les baïonnettes sont en clapotant fixées sur les fusils. La garde de jour, affectée dans le fort et les allées, remplace celle de la nuit.
La porte de notre tunnel s’ouvre en grinçant.
« Deux hommes pour le tonneau ! »
Tout le monde s’y précipite pour accomplir le sale bouleau.
« En arrière ! Deux seulement ! »
Nous nous mettons d’accord entre nous et organisons un service toilettes, puisque tout un chacun veut sortir, peu importe pour quel corvée. Je compte les jours pour savoir quand ce sera mon tour.
Une nuit a suffi pour cette transformation.
Nous sommes une semaine plus tard, à midi.
Les deux grands plats de riz et de pain ont été vidés, les groupes d’hommes accroupis tout autour ont cessé leurs disputes et ont retrouvé leur place, corps à corps l’un à côté de l’autre dans la paille.
Le bon docteur K. de Meißen a été élu chef de groupe. Il a un corps rond, deux colonnes à la place des jambes, des varices remplaçant les vrilles de lierre, pourtant des mains fines comme une jeune fille. Son visage plein dans toute sa détresse rayonne la paix. Il est couvert de poussière et rouge, couvert de poils rouge-marron. Ses yeux, bleu pâle et petits, derrière un pince-nez. Maintenant, le gilet déboutonné, il s’accroupit penseur dans la paille. A ses pieds, sur les dalles de grès gris, un jeu d’échec a été dessiné, à l’aide d’un morceau de mortier arraché du mur. Les figurines, modelées à partir de restes de pain, s’affrontent dans une lutte incertaine.
A côté du docteur saxon, à sa place contre le mur, en pantalon de travail jaune, le visage calcaire et émacié, la barbe et les cheveux noirs et fins, aux yeux d’enfant, grands et rentrés, se tient un homme de travail décharné. C’est un Ruthène autrichien qui, pendant plus de dix ans, a conduit des chariots d’argent dans une mine du Montana. Dans un village des Carpates, il est attendu par femme et enfant, pour qui, dans des puits étrangers, il a souffert silencieusement. Maintenant, il regarde devant soi avec grande modestie et réfléchit sur son malheur : la nuit, le chagrin le creuse, pendant la journée, la clarté lui ferme la bouche. Dans le coin le plus obscur, là où les odeurs du tonneau, utilisé sans interruption, évoquent des visions pestilentielles, est allongé, recroquevillé dans la paille, mouillé par les débordements du tonneau, un Monsieur de C. – Il porte un élégant pardessus gris dans lequel il rentre les genoux, de façon à ce que le tissu recouvre aussi ses pieds. Jour et nuit, heure après heure, il est allongé ainsi et ne bouge pas. La longue ligne de son dos courbé, la tête rentrée, les pieds cachés n’expriment rien que du mépris excluant toute relation. En se baissant, on regarde dans un visage blanc et bouffi, barré de poils noirs de barbe. Des sourcils épais et laids traversent le front, des cils pâles recouvrent les yeux ; quand ils s’ouvrent, cependant, le regard rencontre un œil de brillance métallique qui scintille comme une fosse à purin.
En face de lui, appuyé contre le mur calcaire vert, est assis un jeune homme silencieux. C’est un horloger de Berlin qui est allé chercher le bonheur de sa vie au Guatemala. Une harmonie tranquille se dégage de son front fin et pâle ; dans sa main, il tient un petit livre et lit. Sur le dos du livre en cuir rouge et souple est écrit : Tolstoi, « Résurrection ».
La deuxième semaine est passée
Je suis allongé dans la paille et ne dors pas.
La vermine a transformé mon corps en un champ de bosses rouges.
Mes deux voisins sont des gars au sang chaud et m’excitent.
En même temps, mon corps a froid, touché par l’air de la nuit. Je n’ai pas de manteau, seulement le costume de voyage clair dans lequel j’ai quitté le paquebot hollandais. C’est ainsi que je me lève, dégage la paille de mes pieds et marche en chaussettes de long en large sur les dalles en pierres entre les dormeurs. Près des barreaux en fer des fenêtres, je m’arrête.
A travers de minces fentes, je regarde dans la nuit pluvieuse et pâle.
Des herbes fines se tiennent sur la ligne de faîtage de la maison d’en face et chancèlent dans le vent. L’une d’elles est plus haute que toutes les autres ; le vent peut la saisir avec plus de force : elle se plie de plus en plus profondément jusqu’à la racine, se redresse loin dans le ciel de la nuit et semble pleine d’une douleur glorifiant la vie.
Mes pieds sont engourdis et froids. Je fais demi-tour et rentre dans la sombre salle voûtée. A chaque pas, l’air devient de plus en plus oppressant et épais. A la fin il est étouffant et rempli de relents miasmatiques.
Mon pied devient humide.
J’ai le vertige.
Je m’arrête.
Devant moi, la porte, grise pierre et vieille, s’accroupit.
A côté d’elle, une fenêtre poussiéreuse qui regarde dans le long couloir.
Dehors, une forme humaine souffrante, rabougrie et courbée, marche le fusil sur le bras, un képi rouge moqueur au front. La tête très basse, le visage éclairé par une lanterne est apathique et résigné.
Une douleur croissante saisit mon corps.
Je tape contre la vitre.
Dehors, la forme humaine s’arrête et, à travers la vitre, fixe son regard dans mon visage, s’affole et baisse la baïonnette :
« En arrière ! »
« Ami ! »
« Qu’est-ce qu’il y a ? »
« Nous – tous les deux – sommes malades !! »
Commence la quatrième semaine.
Entre de hauts remparts, couverts de feuilles de vignes, court le fossé du fort.
A son entrée et à sa sortie, des sentinelles sont postées avec leurs fusils étincelants. Leurs pantalons rouges font des taches rouges dans le vert.
Sur le haut, là où le mur se perd dans de doux remparts, du genêt jaune est en fleur, et un petit bois de pins dirige son attente vers le ciel.
Derrière lui, la mer. Loin, loin. Elle respire et bruit. L’œil ne voit pas son flot, mais l’âme, assouplie, boit les vagues de sa brume.
Le signal résonne. La sentinelle appelle, la demi-heure est passée.
Les formes humaines respirantes se détachent des murs. Les corps blancs des gymnastes se couvrent de leurs vêtements.
En rangs, les pieds lourds, ils retournent au cachot.
Il n’y a plus de doute : nous devons partir.
Le petit caporal joufflu l’a dit à l’oreilledu docteur souriant. Pour ce faire, cachant le pourboire, il s’est mis sur les pointes des pieds, et le gros docteur a fait une génuflexion pour s’incliner vers lui. Maintenant, tous les deux ont le visage rouge et rayonnant.
Partout des pas rapides qui claquent, des bruits qui résonnent dans les couloirs et dans la cour.
Les premiers groupes s’y mettent déjà en rang.
Les herbes sur le faîtage du toit sont immobiles dans le soleil doré de l’automne, seule la plus haute est encore saisie par le souffle chercheur : elle tremble dans de fines oscillations.
Devant sa porte de cuisine se tient le cuisinier. Il a mis ses mains derrière son tablier blanc, sale, le képi rouge dédaigneusement repoussé en dégageant le front et, le visage violet et la moustache noire, regarde le départ.
De la vapeur se dégage derrière lui et l’enveloppe, il lance un petit juron dans la cour et reprend ses occupations.
Nous nous mettons en rangs. Des groupes d’artilleurs nous scrutent une dernière fois et semblent joyeux. Nous commençons à marcher. Des supports de pièces d’artillerie, les canons démontés, se tiennent ça et là et ont l’air soulagé : les deux vieux porches viennent et sont pleins de beauté ; le petit bois de pins monte, les genêts et la bruyère sont en fleurs, nous les traversons avant de nous arrêter. Devant nos regards la mer qui roule et respire.
La mer s’étale devant nous, piétinante et retentissante.
Des alouettes sont dans l’air et, avec leur jubilation, déchirent nos cœurs désaccoutumés de toute joie.
C’est très tôt le matin. Toutes les herbes sont encore mouillées, tout le paysage encore plein de rosée et humide. Des voiles de douce brume l’enveloppent. Collines et vallées saluent. Des villages y forment des taches blanches. En décrivant des sauts et de louangeuses vagues, les genêts arpentent le pays. Des champs de légumes, tranquillement verdoyants, s’étendent au milieu d’eux. Notre chemin descend et remonte. Comme les cimes des arbres sont basses ! Une petite chapelle vit en rêvant dans une niche, au bord du chemin de la vallée. Un chariot à ridelles est posé là, à côté d’un cheval qui broute l’herbe. Il y a des rivières qui gargouillent et toujours de nouveau un arbre, une cabane, un regard, un souffle de quelque part et un chemin. L’officier français à côté de moi sur son cheval a un visage arrogant et racé, il ne voit rien et regarde toujours tout droit devant. Mais la mer fume de plus en plus, et le soleil lance tout autour ses rayons en faisceaux dorés.
« Comment s’appelait ce fort ? »
« Crozon. »
« Comme c’est loin derrière nous ! »